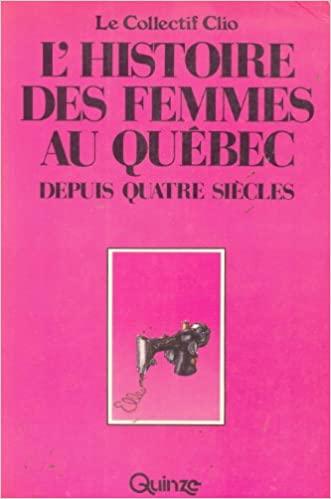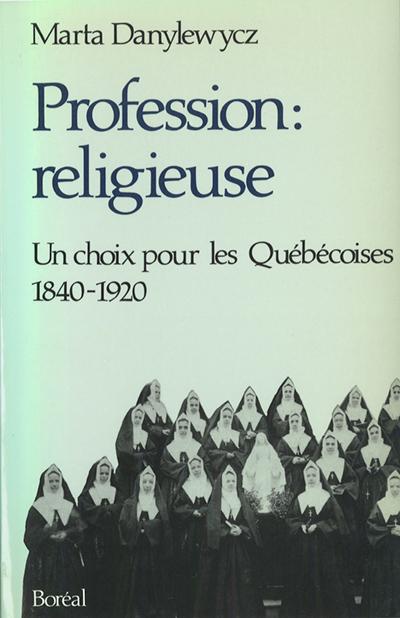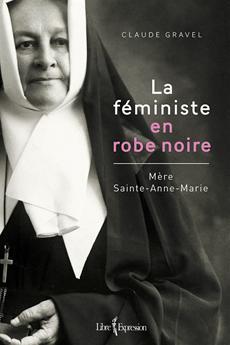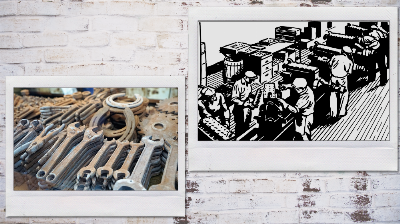Religieuses et féministes
Il y a 27 ans, l’historienne Micheline Dumont publiait un livre intitulé Les religieuses sont-elles féministes? Cette question est au coeur du plus récent numéro de la revue L'autre Parole, qui répond résolument "Oui" à la question - rhétorique - jadis posée par la professeure émérite de l'Université de Sherbrooke. Ce dossier brosse une vue d'ensemble des engagements féministes des religieuses québécoises, et ce, de la Nouvelle-France à nos jours.

Mise en contexte
La lutte pour l’égalité et l’affirmation des droits des femmes plonge ses racines dans les tous débuts du christianisme, comme l’ont rappelé maintes théologiennes au cours des dernières années, à la faveur des débats sur l’accès des femmes aux ministères ordonnés tels que le diaconat, à la demande de l'Union internationale des supérieures générales, porte-voix de plus de 500 000 religieuses dans le monde.
Cette affirmation des femmes trouve aussi des échos dans l’histoire du Québec, et ce, dès l’époque de la Nouvelle-France. Plusieurs historiennes ont mis en exergue le rôle décisif joué par les femmes fortes telles que Jeanne Mance, Marguerite d’Youville, Marie de l’Incarnation ou Catherine de Saint-Augustin dans l’essor de la jeune colonie canadienne. La reconnaissance tardive mais remarquée de Jeanne Mance en tant que confondatrice officielle de la Ville de Montréal est un indice marquant de la place centrale des femmes et des religieuses dans la vie de la jeune colonie. Tout comme d'ailleurs les nombreux travaux ayant mis en valeur les écrits mystiques et le leadership spirituel de Marie de l'Incarnation.
La Nouvelle-France comme époque fondatrice (1608-1760)


Qu’en fut-il de l’affirmation des femmes dans les structures patriarcales de l’Église catholique et celles du régime seigneurial? La trajectoire spirituelle et les choix prophétiques de Marguerite Bourgeoys sont particulièrement éloquents à cet égard. En décidant de faire de la Congrégation Notre-Dame une communauté religieuse non-cloîtrée, elle a considérablement accru la liberté d’action et de mouvement de ses consœurs. Jusque-là, en effet, les religieuses étaient soumises à la règle de la clôture monastique qui interdisait aux sœurs de sortir de leurs couvents. En soustrayant ses «filles» de l’obligation de la clôture monastique, Marguerite Bourgeoys leur a permis de conjuguer contemplation et action, comme ce sera le cas pour les jésuites à la même époque. «C’est ainsi que les premières religieuses s’en allèrent à cheval, en canot ou à pied, faire le catéchisme dans les habitations disséminées le long des côtes du Saint-Laurent. Et pour n’être à la charge à personne, note l’historienne Hélène Bernier, elles devaient travailler à leur propre subsistance».
En cela, les religieuses jouiront d'une liberté accessible à très peu de femmes de cette époque, hormis peut-être quelques veuves héritères issues de la noblesse ou de la bourgeoisie.
Intégrées (parfois bien malgré elles) au régime seigneurial, les communautés religieuses féminines pourront ainsi «rivaliser» avec leurs homologues masculins, en administrant des biens et en finançant leurs œuvres à l’aide des revenus tirés de leurs seigneuries : pensons ici à la seigneurie de Châteauguay et à l’île Saint-Bernard, propriété des Sœurs Grises. Le tout au service d'une éthique de la sollicitude et du soin tâchant de redonner un peu de dignité aux pauvres, aux malades et aux exclus. Sans toutefois échapper aux normes sociales conservatrices de l'époque et sa vision paternaliste de la pauvreté.
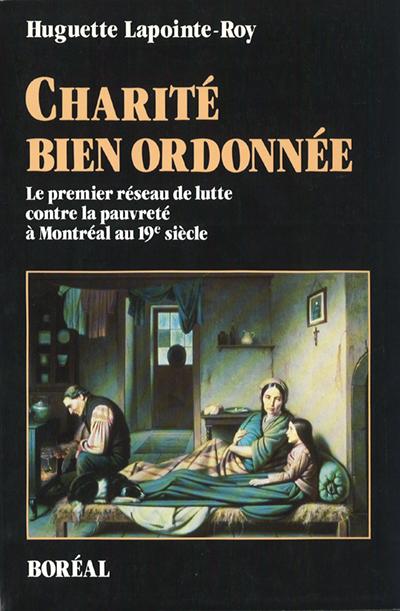

Les religieuses au coeur du tout premier réseau de lutte à la pauvreté (1700-1850)
Les religieuses seront au coeur du tout premier réseau de lutte à la pauvreté, pour reprendre ici la belle formule de l'historienne Huguette Lapointe-Roy. Réseau qui se développe de manière progressive tout au long des 18e et 19e siècles, malgré les inquiétudes suscitées par la Conquête anglaise et le statut précaire de l’Église catholique canadienne, intégrée à un État et un empire officiellement anglicans. À la campagne comme à la ville, c’est le désir de chaque village et de chaque paroisse d’avoir non seulement son église et son curé résident, mais aussi d’avoir «son» couvent de sœurs, «son» collège de frères et « ses » écoles de rang pour voir à la scolarisation des enfants. L’ambition de toutes les communautés paroissiales — même les plus humbles — est de posséder ses propres œuvres de charité afin de pouvoir s’occuper de ses pauvres, ses malades, ses orphelins, etc. Aussi les curés et dames patronesses laïques multiplient-elles les quêtes spéciales, bazars et soirées de bingo afin de lever des fonds, de manière à financer ces œuvres de charité et à construire les infrastructures de prise en charge des pauvres, des malades et des exclus.
Le développement de ces réseaux de charité et d’entraide est cependant mis à rude épreuve par le développement urbain, mais aussi et surtout par l’essor du libéralisme économique et du capitalisme industriel. C’est au milieu du 19e siècle qu’apparaissent les premières usines et chemin de fer sur le territoire du Québec. Et que des paysans et des immigrants fuyant la misère viennent s’installer en ville, s’entassant dans des quartiers ouvriers insalubres, dépourvus d’eau courante, d’égoûts et de… dignité humaine. Et ce, pour travailler dans des usines où les conditions de travail sont inhumaines. Certains de ces paysans réussissent à s’adapter à la dure réalité industrielle. Or, tous n’ont pas cette chance : certains travailleurs sont victimes des mises à pied arbitraires ou d’accidents de travail; d’autres se consument à petit feu, tantôt à cause des maladies industrielles, tantôt à cause de leurs conditions de vie misérables. D’autres, enfin, ne sont pas en mesure de s’adapter au caractère aliénant de la vie industrielle. Broyés par le système, ceux-là finissent par craquer : certains sombrent dans l’alcoolisme, d’autres dans l’itinérance, d’autres dans la spirale de la criminalité; d’autres encore, dans la maladie mentale.
L’Église prisonnière de la morale bourgeoise
Or, l’idéologie dominante de l’époque — le libéralisme — interdit à l’État d’intervenir dans la sphère économique, ou à venir en aide aux pauvres, et encore moins à forcer les patrons à respecter les droits fondamentaux de leurs ouvriers. Sinon, disent-ils, l’État risque de compromettre la compétitivité des entreprises et pis encore de « cautionner » la paresse et la faiblesse morale des pauvres. Pour les libéraux, en effet, la pauvreté n’est pas causée par injustices du système économique capitaliste mais avant tout par l’immoralité des ouvriers — ouvriers qui «boivent» toutes leurs paies, qui battent leurs femmes et enfants, qui condamnent leur famille à mendier et à voler leur pain, qui poussent leurs femmes et leurs filles à se prostituer, etc. Pour les bourgeois, ces anciens paysans fraîchement arrivés en ville sont encore des brutes en puissance que la bonne société doit «civiliser», «réformer» et «moraliser».
Un tel contexte créé une tension entre la charité chrétienne et le réformisme moral bourgeois : il faut aider les pauvres, certes, mais seulement ceux qui «veulent» s’aider. Les œuvres sociales et caritatives mises en place au 19e siècle s’accordent plutôt bien avec la morale bourgeoise et libérale. La visite à domicile par les membres de la Société Saint-Vincent de Paul est un bel exemple du moralisme bourgeois à l’œuvre dans les œuvres de charité. En se rendant sur place pour «évaluer» les besoins des familles, ces laïcs charitables sont aussi en mesure de vérifier si l’on est en face de «vrais» ou de «faux» pauvres. Cela permet d’éliminer certains individus jugés déviants, comme les alcooliques et les «paresseux», considérés «indignes» de recevoir de l’aide. Comme si la pauvreté était un choix. Et comme si l’alcoolisme n’était pas une maladie…
Certaines œuvres de charité participent quant à elle d’une logique de contrôle social. C’est le cas de toutes ces institutions qui ont pour mandat d’interner et de réformer les pauvres, les exclus et les déviants. C’est bien sûr le cas des prisons et des écoles de réforme, qui doivent non seulement punir les délinquants, mais aussi les rééduquer, les remoraliser et les transformer en «bons travailleurs», dociles et bien formés. C’est aussi le cas des maisons d’industrie, ces institutions d’internement destinées à la réforme morale des vagabonds et itinérants. Tout comme des maisons d’internement pour les filles-mères. Les élites bourgeoises se convainquent alors que de tels individus ne mendient (ou ne se prostituent) qu’en raison de leur paresse et de leur faiblesse morale. D’où l’importance de les réformer afin de transformer des individus déviants et instables en ouvriers honnêtes, vertueux et travaillants.
Les religieuses et l’émancipation des femmes et des filles (1850-1960)
Chevilles ouvrières de ces institutions et oeuvres de charité, les religieuses sont aussi partie prenante d'une Église patriarcale qui les cantonne à un rôle de subalternes, et aussi d'une société au sexisme décomplexé. Au milieu du 19e siècle, à la faveur d’un Code civil ô combien misogyne faisant des femmes des mineures perpétuelles de leur père et de leur mari, ne pouvant rien posséder en leur nom, les femmes disposaient d’une marge de liberté extrêmement limitée, où le mariage et la maternité étaient (à peu près) la seule issue pour les femmes. Dans cette optique, la vie religieuse paraîtra à plusieurs jeunes femmes comme une voie d’émancipation : entrer au couvent leur permettait non seulement «d’échapper» au mariage et à la maternité, mais aussi de pouvoir posséder et d’administrer des biens et des œuvres, de manière communautaire.[1] . Et aussi de mener une carrière remplie de sens, en fonction du charisme de l’institut religieux où elles ont choisi de s’engager. Malgré l’austérité morale des couvents d’autrefois, et la tutelle lourde des évêques et aumôniers sur leur vie communautaire, les religieuses ont néanmoins pu vivre une intense sororité au sein de leurs communautés respectives, tout en s’épanouissant aux plans personnel et spirituel. En découvrant aussi leur identité de femme et même de féministes, dans une Église patriarcale et une société misgogyne qui les exclut et les infériorise.
[1] On aurait cependant tort de gommer les motivations proprement spirituelles et croyantes des femmes ayant embrassé la vie religieuse, lesquelles ne se réduisent pas à des simples considérations socio-économiques. Le très misogyne Code civil de la province de Québec a été adopté en 1864. Or, comme l’ont observé Louis Rousseau et Frank Remiggi, les vocations religieuses féminines prennent leur envol au moins 20 ans plus tôt, au cours des années 1840, dans le sillage du réveil religieux catholique de l’après-Durham. Et à une époque où les veuves fortunées comme Émilie Tavernier-Gamelin disposaient de libertés qui disparaîtront par la suite. Bref, dans l’équation, il y a aussi des motivations avant tout religieuses, qui forment l’armature de la féminisation du catholicisme au 19e siècle.
À l’intérieur de son organisation hiérarchique et ministérielle, monopolisée par des hommes célibataires, les femmes sont structurellement bannies et ignorées. Ainsi, la parole d’autorité, les instances de décisions et les rôles symboliques, constitutifs de la communauté ecclésiale, ne sont tenus que par des hommes clercs, qui demeurent entre eux et se « reproduisent » eux-mêmes.
- Marco Veilleux, «La "blessure ontolgique" de l'Église catholique», Réseau des Forums André-Naud, 18 octobre 2018.
Bien conscientes de la liberté dont elles jouissaient, les religieuses ont tenté d’en faire profiter les jeunes filles placées sous leur responsabilité. Non seulement à travers une pédagogie moderne permettant aux jeunes femmes de s’épanouir au plan humain et spirituel, mais aussi en luttant contre les autorités cléricales et politiques de l’époque, afin de permettre aux Québécoises d’accéder au cours classique et aux filières scientifiques. Et, de là, à l’université et à des carrières signifiantes. Au début du 20e siècle, les sœurs de la Congrégation Notre-Dame, les Ursulines et les Religieuses de Jésus-Marie, mettront sur pied des collèges classiques pour filles. Les Sœurs Grises, les Hospitalières de Saint-Joseph et les Augustines créeront quant à elles des écoles enseignant les soins infirmiers. En 1939, Marie Gérin-Lajoie, la fondatrice de l’Institut de Notre-Dame du Bon-Conseil, fondera l’École de travail social de l’Université de Montréal. Des religieuses mettent également en places des jardins d’enfants — lointains ancêtres de nos garderies — afin de permettre aux jeunes mères d’accéder au marché du travail et de s’autonomiser au plan socioéconomique. Permettant ainsi aux femmes et aux filles d’échapper (partiellement) au carcan sexiste de la société conservatrice d’alors.
Non sans paradoxes ni angles morts cela dit. En cantonnant le cours classique et les filières d'enseignement féminin (les écoles de musique, notamment) dans les écoles privées placées sous leur responsabilité, elles ont réservé à une élite fortunée les avenues d'émancipation pour les jeunes québécoises, dont l'immense majorité fréquente l'école publique. C'est en partie pour pallier à cette lacune que des religieuses enseignantes comme Ghislaine Roquet (1926-2016) contribueront à la modernisation et à la démocratisation de l'éducation, en mettant fin à des décennies de sexisme institutionnalisé dans le système scolaire. Cheville ouvrière de la Commission Parent, cette religieuse de la congrégation de Sainte-Croix est aujourd'hui considérée comme l'une des artisanes de la Révolution tranquille.
Pour nous, il n’y avait aucune raison de séparer les filles et les garçons ou de donner des cours spéciaux aux filles. J’avais été désolée de voir que, dans les écoles de formation ménagère (les Instituts familiaux) qui prétendaient conduire les jeunes filles jusqu’au baccalauréat, on donnait un cours édulcoré. Par exemple, en littérature, on ne travaillait pas des œuvres complètes mais des morceaux choisis. Par ailleurs, on ne donnait pas de cours de chimie, mais bien de “chimie alimentaire”. Je t’avoue que j’avais eu un méchant choc. Je me disais que ces filles-là avaient droit de recevoir des cours solides dans toutes les disciplines. C’était important de promouvoir l’éducation des filles avec les mêmes exigences et les mêmes chances de progression dans la vie professionnelle. Tu sais quand on dit que nous avons voulu la démocratisation, ça jouait aussi au niveau de l'équité de l'enseignement donné aux filles et aux garçons.
- Ghislaine Roquet, citée par Louise Bievenue, «Souvenirs d'une commissaire», Bulletin d'histoire politique, 12, 2 (2004), p.111
Soumises à une pression financière extrême, elle-même tributaire du sexisme institutionnel prévalant dans la Belle Province[1], les communautés religieuses ont aussi accepté de travailler pour des salaires dérisoires dans le réseau hospitalier et celui des services sociaux, au nom d'un appel à la vocation et à l'éthique du soin. Ce qui aura des effets pervers et durables sur la rémunération et les conditions de travail offertes dans ces secteurs d'activité, à la main d'oeuvre massivement féminine. Ce qui amènera les enseignantes, les infirmières et bientôt les travailleuses sociales laïques à se syndiquer, pour revendiquer de meilleurs salaires et de meilleures conditions auprès de leurs patronnes religieuses. Lesquelles seront bientôt remplacées par des technocrates masculins de l'État québécois, au sein de ce sexisme de la Révolution tranquille qui a chassé les religieuses des postes de direction qu'elles occupaient jusque-là.
À [l'hôpital] Albert-Prévost, on montre la porte à Charlotte Tassé, une infirmière qui était directrice générale. Les jeunes psychiatres qui ont des ambitions politiques, qui vont devenir ministre comme Camille Laurin, ne tolèrent pas les femmes. Ils disent que les religieuses ne veulent pas avoir des soins modernes, mais elles réclament depuis longtemps les fonds pour faire les réformes qui finalement sont financées dans les années 70, les cliniques externes, par exemple. C’est la même chose à [l'hôpital] Sainte-Justine, les femmes laïques qui dirigent depuis la fondation se font tasser. On a accepté la compétence féminine quand elle était anonyme et gratuite, mais dans l’administration des hôpitaux, on ne semble pas accepter qu’elle soit associée à un salaire de cadre. C’est une entreprise généralisée pour mettre les femmes en état d’autorité à la porte
- Marie-Claude Thiffault, citée par Mathieu Perreault, «Le sexisme de la Révolution tranquille», La Presse, 29 décembre 2020.
[1] Les écoles, hôpitaux et œuvres de charité administrées par les communautés religieuses féminines recevaient des subventions dérisoires de la part du gouvernement québécois, pavant ainsi la voie à des dilemmes éthiques et à des situations scandaleuses. Pensons ici au sort des orphelins de Duplessis, ou encore aux mauvais traitements et aux carences de toutes sortes (alimentaires, socioaffectives, etc.) ayant sévi dans les pensionnats autochtones.
Solidarité avec les luttes féministes (1920-1965)
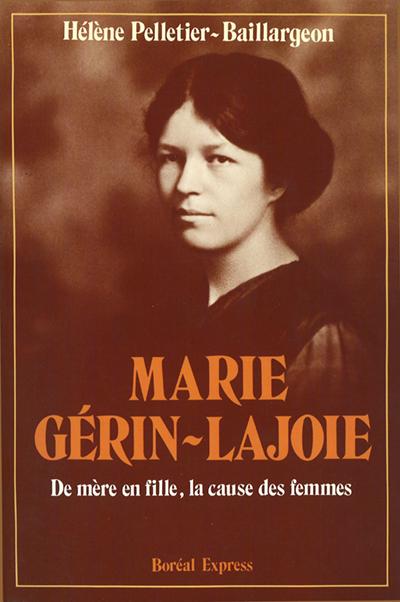

Les laïques ont elles aussi su utiliser de manière subversive les normes religieuses et sociales conservatrices de leur époque afin de libérer les femmes. L’idéologie maternaliste de Marie Lacoste Gérin-Lajoie et de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste en est un bon exemple. S'appuyant sur le rôle social que les élites patriarcales attribuaient aux femmes — celui de mères, d'épouses et de «soignantes» confinées à la sphère domestique— Marie Lacoste Gérin-Lajoie et ses consœurs ont réussi à convaincre les élus du droit de regard des femmes pour toutes les politiques sociales liées au bien-être des femmes et des enfants. Or, comment exercer ce droit de regard, demandent-elles, si on empêche les femmes de s'exprimer sur la question? Et si elles ne sont pas en mesure d'exercer une pression sur les élus, de manière à ce qu'ils votent des lois favorables à la famille et à son épanouissement? Le seul moyen d'y parvenir, diront-elles, consiste à leur octroyer le droit de vote. Ce qu'elles obtiendront en 1940, et ce, quatre ans avant les Françaises vivant pourtant au sein d'une République laïque aux prétentions universalistes.
Prolongeant les intuitions de sa mère, la jeune Marie-Gérin Lajoie est elle-même un pur produit de ce féminisme catholique en pleine ébullition de le Québec du 20e siècle. Née dans une famille bourgeoise mais engagée socialement, élève des religieuses de la Congrégation Notre-Dame, elle sera la première fille canadienne-française à compléter son cours classique et à être détentrice d'un baccalauréat ès arts. Elle milite aux côtés de sa mère au sein de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, puis fonde l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil, une communauté religieuse faisant la jonction entre vie religieuse, action sociale et émancipation féminine. En 1931, elle fonde l'École d'action sociale à Montréal qui jette les bases du travail social au Québec. Ses filles spirituelles poursuivront ses intuitions et ses engagements prophétiques. La trajectoire de Gisèle Turcot est éloquente à ce propos, tout comme les engagements de l'Institut du Bon-Conseil auprès des femmes en difficulté, et ce, tant au Québec qu'à Haïti. En 1975, elles contribuent à la fondation du Carrefour pour elle à Longueuil. Et en 1989, elles soutiennent le développement de l'organisme haïtien Fanm Deside (Femmes décidées) dont elles sont demeurées des alliées indéfectibles depuis ce jour.
L’engagement féministe des religieuses québécoises (1965 à nos jours)
Dans son désir de redynamiser et de démocratiser l’Église catholique, le Concile Vatican II avait mis de l’avant la notion de peuple de Dieu, c’est-à-dire l’idée que l'ensemble des baptisé-es sont des membres à part entière de l’Église et sont donc coresponsables de la mission d’évangélisation. Prolongeant ainsi les innovations pastorales développées au sein des mouvements d’Action catholique. Dans les faits, toutefois, l’Église demeure une affaire d’hommes : malgré les efforts démocratisation et de collaboration entre clercs et laïques, prêtres et évêques continuent de prendre les décisions finales. Les leviers de commande demeurent donc entre les mains d’un boys club clérical.
En maintenant des rapports d’inégalité entre les sexes dans leurs organisations, en mettant de l’avant des modèles féminins de soumission, en cherchant à contrôler la vie des femmes – notamment leur sexualité par des discours moraux misogynes –, les religions favorisent la reproduction de la violence sexiste.
- Marie-Andrée Roy, «La sacralisation du pouvoir mâle», Relations, novembre 2010,

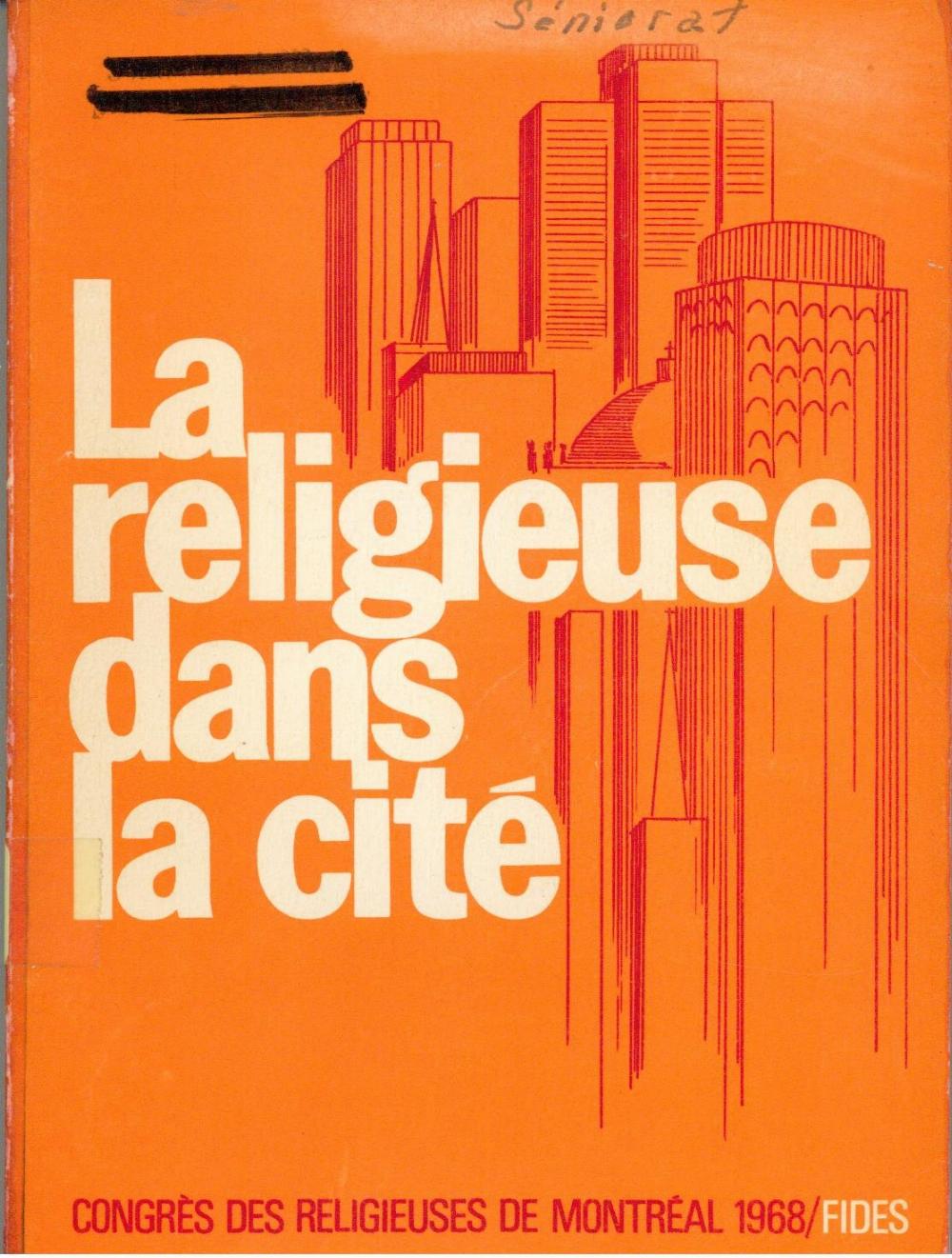

Ce concept de peuple de Dieu est contemporain d’une féminisation de l’action pastorale de l’Église. Il y a plus en plus d’agentes de pastorale dans les paroisses. Et de plus en plus de professeures dans les facultés de théologie. Des religieuses comme Lorraine Caza, Monique Dumais, Yvonne Bergeron, Marie-Thérèse Nadeau et Thèrèse Daviau. Mais aussi des laïques. Qui, ensemble, réfléchissent à la place des femmes dans l’Église et la société. Qui développent une théologie féministe, assortie d’une critique du cléricalisme, du sexisme et du patriarcat ecclésiaux. Le contexte de l'après-Concile rend par ailleurs possible, sinon nécessaire, un renouveau de la vie religieuse. Nombre de communautés religieuses féminines profitent de ce contexte pour se réinventer entièrement et redéployer avec audace le charisme de leurs instituts religieux respectifs, dans une optique de justice sociale, d'émancipation féminine et de solidarité internationale. C’est ainsi que se développent divers réseaux de féministes chrétiennes dans l’Église du Québec, tels que la collective L’Autre parole, le réseau Femmes et Ministères, le Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes, l’Association des religieuses pour les droits des femmes et le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale. Qui militent pour la défense et l’affirmation des droits femmes, et ce, dans l’Église comme dans la société, au Québec comme ailleurs dans le monde. .
Au contact d'autres féministes (notamment au sein de la Fédération des femmes du Québec, dont sont membres plusieurs d'entre elles), les religieuses prennent part aux mobilisations féministes des dernières décennies : elles contribuent à l’abrogation des dispositions sexistes du Code civil, s’engagent pour la défense des droits économiques, sociaux et reproductifs des femmes, et dénoncent le sexisme, la misogynie et le patriarcat sous toutes leurs formes, sur tous les fronts et sur tous les continents, au nom d’une sororité sans frontières.
Les documentaires Radical Grace de Rebecca Parrish (2015) et Ainsi soient-elles de Maxime Faure (2019) sont deux témoignages éloquents de la radicalité (évangélique) des engagements sociaux et féministes des religieuses depuis les années 1960.
Pour aller plus loin
Sur le site Mémoire du christianisme social au Québec
- Le dossier Femmes et société
- L'article consacré à L'Entraide missionaire
- La fiche Témoins consacrée à Gisèle Turcot.
Documentaires
Maxime Faure, Ainsi soient-elles, Les films Balibari | Metafilms, 2019, 75 min.
Rebecca Parrish, Radical Grace, Interchange Productions, 2015, 76 min.
Revues
Pierrette Daviau, (dir.), "Religieuses et féministes: d'hier à aujourd'hui", L'autre Parole, no 158, 2021, 56 p.
- La collection complète de La Bonne Parole, la revue de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, est disponible sur le site de Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BANQ).
- La collection complète de la revue L'autre Parole est disponible sur le site de Bibliothèques et Archives nationales du Québec.
- La collection complète de Reli-Femmes, la revue de l'Association des religieuses pour les droits des femmes, est aussi disponible à la BANQ.
Livres
Lise Baroni, Yvonne Bergeron, Pierrette Daviau et Micheline Laguë, Voix de femmes, voies de passage. Pratiques pastorales et enjeux ecclésiaux, Montréal, Éditions Paulines, 1995, 264 p.
Anita Caron, (dir.), Femmes et pouvoir dans l’Église, Montréal, VLB, 1991, 254 p.
Collectif Clio, L'histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour, 1992, 646 p.
Marta Danylewycz, Profession: religieuse: un choix pour les Québécoises, 1840-1920, Montréal, Boréal, 1988, 248 p.
Monique Dumais et Marie-Andrée Roy, Souffles de femmes. Lectures féministes de la religion, Montréal, Médiaspaul, 1989, 241 p.
Monique Dumais, (dir.), Franchir le miroir patriarcal. Pour une théologie des genres, Montréal, Fides, 2007, 348 p.
Micheline Dumont, Les religieuses sont-elles féministes ?, Montréal, Bellarmin, 1995, 204 p.
Pauline Jacob, Appelées aux ministères ordonnés, Montréal, Novalis, 2007, 254 p.
Danielle Juteau et Nicole Laurin, Un métier et une vocation. Le travail des religieuses au Québec, 1901-1971, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1997, 194 p.
Marie Lavigne et Yolande Pinard, Travailleuses et féministes. Les femmes dans la société québécoise, Montréal, Boréal, 1983, 432 p.
Mathilde Michaud, "Prendre le voile: survivance, piété ou féminisme?", Histoire engagée, 20 novembre 2018.
Hélène Pelletier-Baillargeon, Marie Gérin-Lajoie. De mère en fille, la cause des femmes, Montréal, Boréal, 1985, 424 p.
Marie-Andrée Roy, Les ouvrières de l’Église. Sociologie de l’affirmation des femmes dans l’Église, Montréal, Médiaspaul, 1996, 420 p.